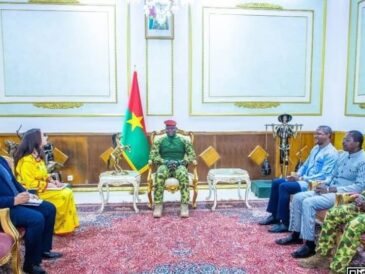Depuis Tenkodogo, le dimanche 29 juin 2025, un message s’est transmis sans discours excessif : l’État Burkinabè cherche, plus que jamais, à reconstruire son autorité sur des bases sociales durables. La visite de courtoisie du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo au Dima de Zoungrantenga, Roi de Tenkodogo, est loin d’être anodine. Derrière la solennité et les bénédictions traditionnelles, se joue un enjeu de fond : renforcer la légitimité de l’État par le relais symbolique et social des autorités traditionnelles.
Une reconnaissance politique des garants coutumiers
Dans un Burkina Faso fragilisé par l’insécurité et les fractures communautaires, les autorités coutumières jouent un rôle de plus en plus central. Le Premier ministre l’a bien compris. Lorsqu’il affirme : « Je viens solliciter vos bénédictions et témoigner ma reconnaissance pour votre engagement en faveur de la paix sociale », il ne s’adresse pas seulement au Roi de Tenkodogo. Il parle à tous les chefs coutumiers, aux communautés, et au peuple burkinabè dans sa diversité. Ce geste s’inscrit dans une logique de gouvernance hybride où le pouvoir politique cherche à s’ancrer dans les représentations sociales et culturelles locales.
Cohésion sociale et autorité partagée
Depuis quelques années, le Burkina Faso vit une recomposition de ses sphères d’influence. L’État moderne, confronté à des limites dans certaines zones rurales, voit son action complétée — voire relayée — par les autorités traditionnelles. Celles-ci assurent, parfois mieux que les structures officielles, la médiation des conflits, la régulation sociale, et même la mobilisation communautaire.
En se rendant à la cour royale de Tenkodogo, le Premier ministre participe à cette dynamique de répartition de l’autorité. Il ne s’agit pas seulement de courtoisie protocolaire, mais d’une volonté de consolider une architecture socio-politique partagée. L’autorité politique, en quête de légitimité territoriale, tend la main à l’autorité traditionnelle, enracinée dans l’histoire et la mémoire collective.
Un signal fort dans un contexte de transition
La Transition actuelle, dirigée par le Capitaine Ibrahim Traoré, a fait de la restauration de l’intégrité territoriale et de la cohésion nationale une priorité. Or, l’adhésion populaire ne peut se construire uniquement à travers des discours sécuritaires. Elle exige des gestes symboliques, des alliances locales, et un ancrage culturel.
La visite du Premier ministre s’inscrit dans cette stratégie. Elle traduit un souci de proximité avec les forces vives traditionnelles, capables de pacifier les tensions sociales et de légitimer les grandes orientations politiques. Le message est clair : le pouvoir exécutif reconnaît l’utilité politique des traditions.
Un pacte tacite entre pouvoir d’État et chefferies
En apparence, l’échange entre le Premier ministre et le Dima de Zoungrantenga s’est voulu simple et respectueux. Pourtant, il consacre un pacte tacite : les autorités traditionnelles offrent leur caution morale, leurs réseaux communautaires et leur capital symbolique ; en retour, le pouvoir d’État les reconnaît comme partenaires essentiels dans la consolidation du tissu social.
Ce pacte repose sur un équilibre délicat. Trop d’ingérence de l’État dans les affaires coutumières pourrait susciter la méfiance. Trop de détachement pourrait affaiblir la cohésion nationale. Il s’agit donc d’un dialogue permanent, où chaque acteur reste dans son rôle, mais travaille à une finalité commune : la stabilité du pays.
La chefferie comme alliée dans la lutte contre l’extrémisme
Face à la montée du radicalisme et de la violence communautaire, les chefs traditionnels jouent un rôle de bouclier social. Ils connaissent les dynamiques locales, parlent la langue du peuple, et bénéficient souvent d’une confiance directe que les représentants de l’État peinent parfois à obtenir.
C’est donc un atout stratégique. Le gouvernement ne peut réussir la lutte contre le terrorisme sans l’appui des forces coutumières et religieuses. La visite à Tenkodogo est un acte diplomatique intérieur. Elle signale à tous les chefs traditionnels que leur place dans la construction nationale est non seulement reconnue, mais recherchée.
Vers une refondation du contrat social ?
À travers ce geste, c’est toute la question du modèle de gouvernance qui se repose. Peut-on durablement bâtir une Nation sans intégrer les formes ancestrales d’organisation sociale ? Le pouvoir actuel semble répondre par la négative. Il prône une réconciliation entre modernité institutionnelle et héritage culturel.
Cette refondation du contrat social implique une revalorisation des structures traditionnelles, non comme vestiges folkloriques, mais comme leviers de transformation. Le Roi de Tenkodogo, par son statut et son histoire, devient alors une figure centrale de cette nouvelle architecture.
Un geste symbolique, un enjeu stratégique
La visite du Premier ministre à Tenkodogo dépasse le cadre d’un simple déplacement. Elle incarne une stratégie plus vaste de reconstruction politique par la proximité, la reconnaissance mutuelle et l’ancrage culturel. Elle montre que dans un Burkina Faso en transition, les clés de l’avenir ne se trouvent pas seulement dans les bureaux de Ouagadougou, mais aussi dans les palais traditionnels de l’intérieur du pays.
A LIRE AUSSI :https://journaldufaso.com/burkina-ghana-une-usine-de-traitement-des-dechets-bientot-implantee-a-ouagadougou/
The post Le Premier ministre à Tenkodogo : symbole d’un pouvoir d’État en quête d’ancrage coutumier appeared first on Journal du Faso.